RTL du 25 septembre 2021 sur les fuites de données
L'Obs du 23 septembre 2021 sur le CBD
Radio Courtoisie du 9 septembre 2021 sur la censure sur les réseaux sociaux
RT France du 18 août 2021 sur Twitter et la désinformation
RT France du 13 août 2021 sur l'affaire Pegasus
Sputnik France du 20 juillet 2021 sur la reconnaissance faciale
Le Parisien du 18 juillet 2021 sur les incitations à la violence par un député
BFMTV du 5 juillet 2021 sur la vaccination des salariés
RT France du 30 juin 2021 sur la centralisation des données de santé
BFMTV du 17 juin 2021 sur les violences sur les hommes politiques
Libération du 16 juin 2021 sur l'enfarinage de personnalités
France InfoTV du 14 juin 2021 sur le mandat d'arrêt international
BFMTV du 11 juin 2021 sur l'affaire Tradel
Le Parisien du 11 juin 2021 sur les raids numériques antivax
RMC du 10 juin 2021 sur l'art 222-13 du code pénal
BFMTV du 4 juin 2021 sur la violence sur les réseaux sociaux
Sputnik France du 4 juin 2021 sur l'affaire Mila
Public Sénat du 3 juin 2021 sur le cyberharcèlement
L'Express du 3 juin 2021 sur les raids numériques
France InfoTV du 3 juin 2021 sur le cyber harcèlement
Al Hurra du 30 avril 2021 sur le projet de loi antiterroriste
France Info du 29 avril 2021 sur la tribune des généraux
RMC du 29 avril 2021 sur le pass sanitaire
Sud Radio du 28 avril 2021 sur le projet de loi anti-terroriste
RT France du 5 avril 2021 sur la regulation des Gafam
Sputnik France du 23 mars 2021 sur les faux en écritures publiques
NextInpact du 17 mars 2021 sur le blocage sur Twitter par un élu
Sputnik France du 12 mars 2021 sur la surveillance du port des masques dans les transports
Revue Dessinée du 11 mars 2021 sur les drones
South China Morning Post du 5 mars 2021 sur le blocage de CGTN
Sud Radio du 3 mars 2021 sur la fin des CRP automatiques
RT France du 27 février 2021 sur la taxation des Gafam
FR3 du 21 février 2021 sur les réseaux sociaux nouvelle arme du fisc
Le Parisien du 21 février 2021 sur le pass sanitaire
Atlantico du 21 février 2021 sur l'utilisation des caméras et drones
Sud Radio du 19 février 2021 sur la surveillance par algorithme du fisc
RT France du 18 février 2021 sur les fakes news
Sputnik du 12 février 2021 sur la manipulation de l'information
Dossier Familial du 8 février 2021 sur la verbalisation au domicile pendant le confinement
Europe 1 du 7 février 2021 sur les risques pour les canulars de youtubeurs
Sud Radio du 4 février 2021 sur l'affaire du Siècle
Sud Radio du 5 janvier 2021 sur les fichiers de police
La Croix du 24 décembre 2020 sur les cagnottes solidaires
Sputnik du 21 décembre 2020 sur l'anonymat sur internet
Parisien du 7 décembre 2020 sur les fichiers de police
Le Figaro du 30 novembre 2020 sur l'affaire Zecler
L'Express du 28 novembre 2020 sur la loi Sécurité globale
Sputnik France du 20 novembre 2020 sur la loi Sécurité globale
Dossier Familial du 9 novembre sur les fichiers de police
France Info du 29 octobre 2020 sur la loi martiale et état de siège
France 24 du 22 octobre 2020 sur la dissolution d'associations
BFMTV du 21 octobre 2020 sur la justice pénale des mineurs
L'Express du 20 octobre 2020 sur la surveillance des réseaux sociaux
LCI du 20 octobre 2020 sur la publication de données personnelles
BFMTV du 16 octobre 2020 sur l'attestation de déplacement
Les Numériques du 14 octobre 2020 sur le déverouillage des téléphones
Le Figaro du 13 octobre 2020 sur le couvre feu
20 minutes du 23 septembre 2020 sur l'affaire Marvel Fitness
Al Hurra du 21 septembre 2020 sur le port du voile
RT France du 18 septembre 2020 sur l'interdiction de Tik Tok
LCI du 15 septembre 2020 sur la difficile reprise des lieux squattés
RMC du 5 septembre 2020 sur l'affaire Crocq et la diffusion sur Facebook
BFMTV du 4 septembre 2020 sur la décision du TA de Lyon sur le port du masque
Sputnik France du 29 août 2020 sur le redressement fiscal de Facebook
BFMTV du 29 août 2020 sur l'article injurieux contre Danielle Obono
Mediapart du 25 août 2020 sur l'interdiction de TikTok aux USA
Marianne du 26 août 2020 sur la légalité du topless sur la plage
RT France du 23 août 2020 sur l'interdiction de TikTok
Sputnik France du 17 août 2020 sur les rave parties
La Croix du 14 août 2020 sur le recours contre France télévisions sur la GPA
RT France du 8 août 2020 sur la labellisation des médias sur Twitter
Sputnik France du 4 août 2020 sur le bilan d'Hadopi
Mediapart du 30 juillet 2020 sur la droit de filmer la police
BFMTV le 13 juillet 2020 sur le port du masque obligatoire
Sud Radio du 7 juillet 2020 sur la nomination du Garde des Sceaux
RT France du 7 juillet 2020 sur le droit de manifester
Al Hurra du 5 juillet 2020 sur la CJR
ZDNET du 3 juillet 2020 sur la transparence des algorithmes
Acteurs Publics du 30 juin 2020 sur l'open data des décisions de justice
RT France du 26 juin 2020 sur la reconnaissance faciale
ZDNET du 26 juin 2020 sur la Justice qui se numérise
RT France du 19 juin 2020 sur la loi Avia
La Croix du 10 juin 2020 sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques
Le Journal des maires de juin 2020 sur la protection fonctionnelle des élus
Sud Radio du 9 juin 2020 sur la liberté d'expression
RT France du 27 mai 2020 sur l'appli StopCovid
Sputnik France du 22 mai 2020 sur les données de santé
Al Hurra du 21 mai 2020 sur la loi Avia
RT France du 13 mai 2020 sur la loi Avia
Sputnik France du 13 mai 2020 sur la loi Avia
Sud Radio du 12 mai 2020 sur les plaintes déposées devant le gouvernement
Le Parisien du 11 mai 2020 sur la mise en place du déconfinement en entreprise
La Croix du 3 mai 2020 sur le fichier SIDEP
Sud Radio du 28 avril 2020 sur l'application StopCovid
Mediapart du 25 avril 2020 sur l'utilisation des drones de surveillance
GQ d'avril 2020 sur les deepfakes
Sud Radio du 13 avril 2020 sur le traçage numérique
RT France du 10 avril 2020 sur les drones de surveillance
La Croix du 8 avril 2020 sur la détention provisoire
Le Monde du droit du 6 avril 2020 sur le décret DataJust
BFM du 3 avril 2020 sur les drones de surveillance
Sputnik france du 1er avril 2020 sur la géolocalisation
France 2 et France Info du 3 mars 2020 sur le fichier Gendnotes
BFM du 21 février 2020 sur l'affaire Pavlenski
Sud Radio du 19 février 2020 débat sur la haine sur les réseaux sociaux
C News du 19 février 2020 sur le revenge porn
RT France du 18 février 2020 sur l'anonymat sur internet
BFM du 17 février 2020 sur le pornodivulgation
Sud Radio du 13 février 2020 sur le contrôle judiciaire et les demandes de remises en liberté
Le Télégramme de Brest du 9 février 2020 sur les caméras de surveillance
RT France du 3 février 2020 sur la grève des avocats
La Croix du 30 janvier 2020 sur le déblocage des téléphones par la police
RT France du 21 janvier 2020 sur la Loi Avia sur la cyberhaine
France Info du 14 janvier 2020 sur le droit de filmer la police
Ouest France du 13 janvier 2020 sur le blocage des examens dans les facs
Libération du 10 janvier 2020 sur la doctrine d'emploi des LBO
RT France du 9 janvier 2020 sur la grève des avocats
France Inter du 31 décembre 2019 sur l'application Alicem
Medi 1 du 31 décembre 2019 sur l'affaire Carlos Ghosn
La Croix du 30 décembre 2019 sur la reconnaissance faciale
20 minutes du 30 décembre 2019 sur le SNDV
NextInpact du 26 décembre 2019 sur le SNDV
RT France du 24 décembre 2019 sur l'application Alicem
LCI du 18 décembre 2019 sur les salariés forcés de changer de prénom
France Info du 17 décembre 2019 sur le droit de filmer la police
L'Obs du 11 décembre 2019 sur l'amendement Grand
Libération du 10 décembre 2019 sur le droit de filmer la police
BFMTV du 6 décembre 2019 sur le droit de filmer dans une salle d'audience
Ouest France du 5 décembre 2019 sur le covoiturage
CaféBabel du 15 novembre 2019 sur le statut des repentis
LCI du 6 novembre 2019 sur la légalité de la cagnotte Balkany
Le Parisien du 1er novembre 2019 sur les menaces par internet
BFMTV le 28 octobre 2019 sur le procès Balkany
Mediapart du 19 octobre 2019 sur le projet serenecity
20 Minutes du 29 octobre 2019 sur la reconnaissance faciale
Le Parisien du 16 octobre 2019 sur le port du voile dans l'espace public
BFMTV du 14 septembre 2019 sur le procès Balkany
RT France du 13 septembre 2019 sur le libra en Europe
RFI du 15 août 2019 sur la légalité des tests ADN
La Croix du 13 août 2019 sur le fichage judiciaire
France 3 du 12 août 2019 sur la règlementation des trottinettes
LCI du 6 août 2019 sur le délit d'outrage sexiste un an après
RT France du 24 juillet 2019 sur les sanctions CSA
BFMTV du 16 juillet 2019 sur le cadre juridique des émojis
BFM Business du 12 juillet 2019 sur les drones de surveillance
Sputnik du 11 juillet 2019 sur la taxe Gafa et les mesures de rétorsion us
RT France du 9 juillet 2019 sur la loi Avia
BFMTV et RMC du 9 juillet 2019 sur le procès de Bernard Tapie
La Croix du 5 juillet 2019 sur la loi Avia
Le Figaro du 3 juillet 2019 sur la loi anti-fessée
France Inter du 25 juin 2019 sur Facebook et les contenus haineux
Public Sénat du 24 juin 2019 sur la canicule et le droit du travail
France Soir du 21 juin 2019 sur la légitime défense pendant les cambriolages
France 2 du 3 juin 2019 sur les drones de surveillance de la police
BFMTV du 29 mai 2019 sur l'utilisation de Facebook dans la succession Hallyday
L'Obs du 28 mai 2019 sur l'art 11 du Code de procédure pénale
L'Express du 23 mai 2019 sur le secret des sources des journalistes et le secret défense
RT France du 23 mai 2019 sur la collecte déloyale de données personnelles
LCI du 22 mai 2019 sur le licenciement pour refus de travail du dimanche
Le Parisien du 22 mai 2019 sur la légalité des kits ADN
Sud Ouest du 21 mai 2019 sur l'affaire des 1000 potes
TF1 du 20 mai 2019 sur la saisie pénale contre les gilets jaunes
BFMTV du 20 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany
Libération du 20 mai 2019 sur la collecte de données personnelles
BFMTV du 19 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany
LCI du 18 mai 2019 sur la légalité de la saisie du patrimoine de Gilets jaunes
France Info du 17 mai 2019 sur le litige RN/FI sur les tracts electoraux
BFMTV du 17 mai 2019 sur la légalité des kits ADN
France Soir du 16 mai 2019 sur le droit des secours en mer
France Info du 16 mai 2019 sur la règlementation des affiches electorales
Sud Radio du 15 mai 2019 sur la lutte contre les contenus haineux sur internet
RT France du 14 mai 2019 sur la protection consulaire
Mieux Vivre votre argent du 9 mai 2019 sur la discrimination au logement
Ouest France du 9 mai 2019 sur les cameras piétons de la police municipale
France Info du 8 mai 2019 sur la violation de sépulture
LCI du 7 mai 2019 sur la discrimination au logement
RT France du 6 mai 2019 sur la règle d'équité du temps de parole de la campagne européenne
France 2 et France Info du 5 mai 2019 sur la sécurité des drones médicaux
LCi du 4 mai 2019 sur la pratique de la nasse
Science et Avenir du 3 mai 2019 sur les drones
KBS du 1er mai 2019 sur la légalité des implants sous cutanés
L'Express du 30 avril 2019 sur les PMC
Libération et BFMTV du 26 avril 2019 sur le droit de filmer une interpellation
BFMTV du 20 avril 2019 sur le caractère probatoire des PMC
Arte du 14 avril 2019 sur la e-résidence en Estonie
France Soir du 2 avril 2019 sur la loi anti-cagoule
Public Sénat du 9 avril 2019 sur le financement des partis politiques
Le Télégramme du 9 avril 2019 sur le droit des drones
Marianne du 9 avril 2019 sur la taxe GAFA
La Voix du Nord du 7 avril 2019 sur les amendes LEZ à Anvers
RT France du 3 avril 2019 sur le blocage par Twitter de la campagne du gouvernement
LCI du 2 avril 2019 sur la fronde des prud'hommes contre les barèmes de licenciement
CGTN du 30 mars 2019 sur l'emploi des LBD
Libération du 30mars 2019 sur les produits chimiques codés
M6 du 29 mars 2019 sur la procédure en cours sur la loi applicable à l'héritage de Johnny Hallyday
France Info du 23 mars 2019 sur les amendes pour manifestations interdites
TF1 et France 3 WE du 23 mars 2019 pour l'affaire des Milles Potes
C Dans l'Air du 23 mars 2019 sur les PMC
Huffington Post du 23 mars 2019 sur les drones de surveillance
France Info du 22 mars 2019 sur les interdictions de manifester
Sud Ouest et FR3 du 22 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes
Europe 1 et Le Figaro du 21 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes
Radio Classique, Sud Radio et RT France du 20 mars 2019 sur les produits marquants chimiques
BFMTV du 19 mars 2019 sur les PMC
Cheek Magazine du 19 mars 2019 sur les frotteurs du métro
Le Parisien du 19 mars 2019 sur les produits marquants chimiques
LCI du 19 mars 2019 sur les PMC
Le Figaro du 19 mars 2019 sur les PMC
BFMTV du 19 mars 2019 sur les arnques sur Facebook
TF1 du 18 mars 2019 sur l'article 40 du CPP
RMC du 18 mars 2019 sur les contraventions pour manifestation interdite
Canal Plus du 17 mars 2019 sur le cyberharcèlement
France Soir du 15 mars 2019 sur les arrestations abusives
TICPharma du 15 mars 2019 sur la Blockchain Vs RGPD
BFMTV du 14 mars 2019 sur les arnaques dans les publicités sur Facebook
GameKult du 6 mars 2019 sur le jeu violent rapde Day retiré par Valve
BFMTV du 1er mars 2019 sur la transparence de l'algorithme du Grand débat national
Le Pélerin du 28 février 2019 sur les caméras de surveillance dans les églises
Blog du Modérateur du 28 février 2019 sur le comportement des salariés sur les réseaux sociaux
Public Sénat du 21 février 2019 sur les réseaux sociaux et les propos haineux
Le Parisien du 21 février 2019 sur comment lutter contre les propos haineux sur internet
Développez.com du 18 février 2019 sur le droit des émojis
Courrier des Cadres du 18 février 2019 sur les dérapages des salariés sur les réseaux sociaux
Süddeutsche Zeitung du 16 février 2019 sur le gaspillage alimentaire
France Soir du 15 février 2019 sur la loi Anticasseur
Courrier des Cadres du 15 février 2019 sur le licenciement causé par un harcèlement au travail
RT France du 15 février 2019 sur le refus d'accréditation de journalistes
France Info du 15 février 2019 sur le cyberharcèlement
Sputnik News du 14 février 2019 sur l'espionnage des smartphones
Blog du Modérateur du 13 février 2019 sur l'utilisation des réseaux sociaux au travail
Public Sénat du 12 février 2019 débat sur les réseaux sociaux
Le Figaro du 12 février 2019 sur le cyberharcèlement
Blog du Modérateur, France Info du 12 février 2019 sur la ligue du Lol
L'Express et Le Parisien du 11 février 2019 sur la ligue du LOl
Agoravox du 10 février 2019 sur les LBD
France Info du 10 février 2019 sur le gaspillage alimentaire
Le Parisien du 5 février 2019 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
Al Hurra du 4 février 2019 sur les relations Iran-UE et l'Instex
France Bleue, le Monde et RTL du 4 février 2019 sur le gaspillage alimentaire
RT France du 2 février 2019 sur les réseaux sociaux
Al Hurra du 25 janvier 2019 sur la légalité des LBD40
RT France du 25 janvier 2019 sur la neutralité du net
Figaro Magazine 24 janvier 2019 sur l'espionnage de Bercy via les réseaux sociaux
France Soir du 24 janvier 2019 sur le blocage des sites internet
LCI du 22 janvier 2019 sur la protection des données personnelles sur le site Grand Débat
Le Figaro du 21 janvier 2019 sur l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat
Blockchain Land du 18 janvier 2019 sur la nouvelle règlementation de la blockchain en France
France Soir du 16 janvier 2019 sur la non assistance à personne en danger
Droit travail France du 16 janvier 2019 sur les chauffeurs Uber
CNN et France Soir du 15 janvier 2019 sur les amendes pour port du gilet jaune
RT France du 14 janvier 2019 sur l'affaire Lafarge
Gazette des Communes du 14 janvier 2019 sur le blocages des élus sur Twitter
Sputnik News du 14 janvier 2019 sur la reconnaissance faciale et ses dangers
LCI du 11 janvier 2019 sur la résistance des CPH pour les ordonnances Macron
Le Parisien et l'Express du 9 janvier 2019 sur la cagnotte Leetchi du boxeur Dettinger
France 3 du 8 janvier 2019 sur les enjeux juridiques de la video surveillance en France
RT France du 8 janvier 2019 sur les pouvoirs du CSA
FranceInfo TV du 7 janvier 2019 sur les menaces de mort sur Twitter
20 Minutes du 4 janvier 2019 sur le vrai du faux des manifestations
CrowdFund Insider du 4 janvier 2019 sur le décret blockchain
France Soir du 26 décembre 2018 sur la publication de l'identité des terroristes
RT France du 21 décembre 2018 sur la loi Fake news et le conseil constitutionnel
France 24 du 21 décembre 2018 sur la règlementation des drones
Radio Méditerranée International du 20 décembre 2018 sur la GAV Carlos Goshn
France Soir du 11 décembre 2018 sur le travail à Noel et jour de l'an
RT France du 6 décembre 2018 sur le plan européen contre la désinformation
Capital du 30 novembre 2018 sur les food techs et la requalification des livreurs à vélos
Sputnik news du 26 novembre 2018 sur les robots soldats
20 Minutes du 25 novembre 2018 sur l'affaire Morandini
France Soir du 22 novembre 2018 sur la règlementation des trottinettes electriques
Femme actuelle du 22 novembre 2018 sur l'espionnage de son conjoint
RT France du 21 novembre 2018 sur la loi Fake News
Passeport Santé du 15 novembre 2018 sur le fichage ADN
Le Parisien du 14 novembre 2018 sur les fichiers de police
Dossier Familial du 14 novembre 2018 sur les Gilets Jaunes
RT France du 13 novembre 2018 sur la liberté d'information
RT France du 6 novembre 2018 sur le rejet par le Sénat de la loi manipulation de l'information
Al Hurra du 5 novembre 2018 sur les mandats d'arrêts internationaux
France Info du 31 octobre 2018 sur les aides fiscales de l'Anah
Capital du 31 octobre 2018 sur la rupture conventionnelle
France Soir du 24 octobre 2018 sur les perquisitions et l'art 4 de la Constitution
RT France du 23 octobre 2018 sur la loi Fake news
BFM du 22 octobre 2018 sur la piétonnisation des berges
L'Est Républicain du 14 octobre 2018 sur la lutte contre le bizutage
Radio Classique du 11 octobre 2018 sur les sanction de l'ONU sur le port du voile
Le Parisien du 10 octobre 2018 sur le fichage des salariés
France Soir du 4 octobre 2018 sur le principe de fraternité
Al Hurra du 27 septembre 2018 sur la légalité d'une taxe Hallal
La Dépêche du Bassin du 27 septembre 2018 sur "l'affaire des Mille Potes"
Mieux VIvre votre argent de septembre 2018 sur les Ehpad
L'Express du 17 septembre 2018 sur l'algorithme antifraude de Bercy
Sputnik News du 14 septembre sur la taxation des Gafa
Radio Méditerranée International du 11 septembre 2018 sur les critiques envers la CPI
Ouest France du 8 septembre 2018 sur les dangers du covoiturage
Society du 7 septembre 2018 sur l'espionnage entre conjoints
France Soir du 6 septembre 2018 sur la loi ELAN et les locataires de HLM
RT France du 5 septembre 2018 sur le rapport Caps-Irsem
France 2 du 1er septembre 2018 au JT 20 h sur l'affaire BlablaCar
France Info du 29 août 2018 sur les prélèvements ADN chez Prisma
BFMTV du 21 août 2018 sur les marchands de sommeil
RMC du 21 août 2018 interview par JJ Bourdin sur la soumission de persones vulnérables à un habitat indigne
France 2 du 20 août 2018 au JT de 20h pour parler lutte contre les marchands de sommeil
20 Minutes du 17 août 2018 sur la réquisition du scooter par un policier
Téléstar du 17 août 2018 sur l'affaire Morandini
France Info du 17 août 2018 sur la notion de réquisition par la police
Le Parisien du 16 août 2018 sur la réquisition d'un véhicule par la police
France Soir du 14 août 2018 sur les locations saisonnières
BFMTV du 10 août interview sur la responsabilité des gérants du camping inondé dans le Gard
Voici du 10 août 2018 sur le harcèlement de mineures par des youtubeurs
Le Parisien du 9 août 2018 sur le #balancetonyoutubeur
Sud Radio le 8 août 2018 sur le régime juridique des piscines familiales
Sputnik News du 8 août 2018 sur les néonicotinoïdes et le recours européen de Bayer
Capital du 7 août 2018 sur le droit à la déconnexion
France Soir du 6 août 2018 sur le sexe au travail
Têtu du 6 août 2018 sur l'affaire Barnum
Capital du 3 août 2018 sur la responsabilité pénale des mineurs
RT France du 26 juillet 2018 sur la loi sur la loi Fake news
France Soir du 25 juillet 2018 sur le délit d'upskirting
France Info du 12 juillet 2018 sur l'accès des parents au compte Facebook de leur fille décédée
Radio Classique du 10 juillet 2018 sur le port du maillot de bain en ville
France Soir du 5 juillet 2018 sur les recours pour les notes du bac
France Soir du 4 juillet 2018 sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle
RT France du 4 juillet 2018 sur la loi sur la manipulation de l'information
Revue Sang Froid de juillet 2018 sur les mandataires sportifs
RT France du 26 juin 2018 sur le détournement de fonds publics
M6 du 18 juin 2018 sur l'affaire des 1000 potes
France Soir du 18 juin 2018 sur les locations AirBnB
France24 du 5 juin 2018 sur le cannabis et la vente de CBD
Al Hurra du 30 mai 2018 sur la libértion des djihadistes fraçais
RT France du 30 mai 2018 sur la loi sur la manipulation des fausses informations
LCI du 28 mai 2018 sur la légitime défense
Aleteia du 25 mai 2018 sur le RGPD
France Soir du 25 mai 2018 sur le RGPD
BFM du 23 mai 2018 sur les enfants youtubeurs
RT France du 23 mai 2018 sur la loi Fake news
Le blog du modérateur du 22 mai 2018 sur le RGPD
Sputnik news du 22 mai 2018 sur la baisse des allocations sociales
Dernières Nouvelles Alsace du 21 mai 2018 sur les testaments numériques
Catherine Daar LIve du 17 mai 2018 sur le RGPD
Radio Classique du 14 mai 2018 sur les raids numériques
Agoravox du 4 mai 2018 sur le droit des robots
RT France du 30 avril 2018 sur la loi Fake News
Le Figaro du 27 avril 2018 sur le cadre légal des émojis
France 3 Corse du 25 avril 2018 sur le statut des repentis
France Soir du 25 avril 2018 sur le paiement des impôts
Huffington Post du 18 avril 2018 sur les remboursements de billets par la SNCF
Sud Ouest du 18 avril 2018 sur la correctionnalisation de l'affaire des viols à Arcachon
France Soir du 17 avril 2018 sur les affaires Lelandais
France Info du 17 avril 2018 sur les grèves Sncf
France 3 du 17 avril 2018 sur le remboursement des billets pendant les grèves
Marianne du 6 avril 2018 sur la police prédictive
RT France du 5 avril sur le projet de loi fake news
France Soir du 5 avril 2018 sur les CGU de Facebook
MediakWest du 5 avril 2018 sur le droit du ESport
RT France du 1er avril 2018 sur les contrôles douaniers transfrontaliers
L'Humanité du 30 mars 2018 sur le projet Big date de Marseille
Revue Sang Froid du 29 mars 2018 sur le cyberHarcèlement
Village de la Justice du 26 mars 2018 sur le secret professionnel des avocats
France Soir du 21 mars 2018 sur la grève SNCF et les droits des usagers
Public Sénat du 19 mars 2018 débat sur le Projet de loi Données personnelles
France 24 du 19 mars 2018 sur la lutte contre la haine sur internet
France Soir du 16 mars 2018 sur l'outrage sexiste et le harcèlement
RT France du 15 mars 2018 sur les poursuites contre Aple et Google pour pratiques abusives
Al Hurra du 15 mars 2018 sur la réforme des prisons
La Tribune du 12 mars 2018 ur l'égalité salariale
Arte du 9 mars 2018 débat sur l'égalité salariale
France 24 du 1er mars 2018 sur la diffusion d'images violentes sur internet
France Soir du 27 février 2018 sur l'ouverture de la PMA
Al Hurra du 26 février 2018 sur le PL sur la déradicalisation
RT France du 23 février 2018 sur l'interdiction du voile intégral en Europe
Les Echos du 23 février 2018 sur l'affaire Pitch et la protection des marques
Sputnik news du 21 février 2018 sur le statut de demandeur d'asile
France Soir du 19 février 2018 sur l'enregistrement d'une personne à son insu
M6 du 19 février 2018 sur le statut des repentis
Le Parisien Eco du 5 février 2018 sur le coût d'un stagiaire
France Soir du 5 février 2018 sur le don d'organes http://www.francesoir.fr/societe-sante/don-organe-refus-consentement-presume-quelles-regles-cadre-legal-carte-donneurs-etats-generaux-bioethique-loi-droit-thierry-vallat-avocat
Public Sénat du 31 janvier 2018 débat sur les voitures autonomes https://www.dailymotion.com/vid
France 2 du 29 janvier 2018 débat sur le revenge Porn https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-etc/404927-revenge-porn-nouveau-danger.html
20 Minutes du 25 janvier 2018 sur la reconnaissance faciale dans les lycées http://www.20minutes.fr/societe/2208103-20180125-video-education-questions-posent-reconnaissance-faciale-abords-lycees-paca
20 Minutes du 24 janvier 2018 sur l'affaire Jeremstar et la preuve par Snapchat http://www.20minutes.fr/high-tech/2208271-20180124-video-affaire-jeremstar-video-postee-snapchat-peut-servir-preuve-devant-justice
France Soir du 19 janvier 2017 sur le bitcoin http://www.francesoir.fr/tendances-eco-france/bitcoin-peut-creer-societe-dont-le-capital-constitue-de-crypto-monnaies-apport-numeraire-evaluation
France Soir du 19 janvier 2017 sur JeremStar et le revenge Porn http://www.francesoir.fr/culture-medias/affaire-jeremstar-buzz-blogueur-voulait-parler-de-revenge-porn-video-intime-masturbation-aqababe-dans-le-prochain-numero-salut-les-terriens-c8-slt-thierry-ardisson
France 2 du 17 janvier 2018 JT de 20h sur l'expulsion des Zadistes de NDDL
Editions Francis Lefebvre du 17 janvier 2018 sur la fiscalité es bitcoins https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=r-00a8a0ff-a6c0-4f7c-ab27-79e6f19f567f
ETB du 12 janvier 2018 sur la trêve hivernale en France
France 5 du 10 janvier 2018 interview dans C dans l'Air sur l'infraction d'outrage sexiste
M6 du 4 janvier 2018 dans le JT sur l'égalité salariale https://www.youtube.com/watch?v=XLyznd6NW28
Europe 1 du 4 janvier 2018 débat sur les fakes news http://www.europe1.fr/societe/une-loi-contre-les-fake-news-un-vrai-casse-tete-3537071
JDD du 1er janvier 2018 interview sur les sextorsions par internet http://www.lejdd.fr/societe/sextorsion-quand-les-hommes-sont-pris-pour-cibles-sur-internet-3533942
France 5 du 30 décembre 2017 interview pour C Dans l'air sur l'éthique des voitures autonomes
RT France du 30 décembre 2017 interview sur l'algorithme de Bercy traqueur de fraude fiscale
Village de la justice du 28 décembre 2017 sur les amendes pour stationnement impayées https://www.village-justice.com/articles/stationnement-impaye-qui-change-1er-janvier-2018-avec-fps-recouvrement-des,26798.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS
Sputnik International du 22 décembre 2017 sur WhatsApp et Facebook https://sputniknews.com/business/201712221060238374-facebook-whatsapp-france-sanctions-commentary/
Sputnik France du 20 décembre 2017 débat sur la fin de la neutralité du Net https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201712211034444080-internet-usa/
France Soir du 20 décembre sur la trêve hivernale http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/treve-hivernale-logement-squat-loyers-impayes-expulsion-jugement-regles-droit-avocat-dates-novembre-mars-thierry-vallat-conditions
FranceInfoTV du 18 décembre 2017 Interview sur les drones
Les Echos du 14 décembre sur les bitcoins https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301023356585-impots-les-5-questions-a-se-poser-avant-dacheter-des-bitcoins-2138454.php
Europe 1 du 13 décembre 2017: interview sur les bitcoins http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/quelles-sont-les-precautions-a-prendre-pour-un-detenteur-de-bitcoins-3520253
Le Figaro du 12 décembre 2017 sur la fiscalité des bitcoins http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/12/20002-20171212ARTFIG00260-le-bitcoin-dans-le-viseur-de-tracfin.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1513113820
Runway Magazine du 12 décembre 2017 sur le harcèlement sexuel dans la mode https://runwaymagazines.com/models-sexual-harassment-world-fashion/
Capital du 7 décembre 2017 sur la fiscalité du bitcoin https://www.capital.fr/votre-argent/le-casse-tete-de-limposition-du-bitcoin-1259539
France Soir du 6 décembre 2017 sur le droit des achats en ligne http://www.francesoir.fr/lifestyle-shopping/les-regles-de-la-vente-achat-en-ligne-et-les-pieges-eviter-que-faire-livraison-remboursement-prix-deffectueux-thierry-vallat-droit-loi
20 Minutes du 4 décembre 2017 sur le projet Big Data à Marseille http://www.20minutes.fr/marseille/2180687-20171204-video-marseille-veut-utiliser-donnees-informatiques-ville-plus-sure-big-brother-prouesse-technologique
Sputnik News du 1er décembre 2017 interview sur la surtaxe sur les dividendes https://fr.sputniknews.com/france/201712011034123938-conseil-constitutionnel-entreprises-franaises/
Rolling Stone du 24 novembre 2017 sur Facebook royaume des morts https://www.rollingstone.fr/facebook-royaume-morts/
L'Express du 22 novembre 2017 sur le travail des enfants dans les chaines YouTube https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/youtube-ferme-la-chaine-toy-freaks-apres-des-accusations-de-maltraitance_1962598.html
France 24 du 14 novembre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge
Mag RH du 13 novembre 2017 sur le droit des robots
Ouest France du 9 novembre 2017 sur le cyber-harcèlement https://www.ouest-france.fr/societe/harcelement-entre-enfants-le-smartphone-est-une-arme-de-destruction-massive-5367545
20 minutes du 8 novembre 2017 sur l'immunité européenne en matière de tweets http://www.20minutes.fr/societe/2149443-20171012-provocation-haine-raciale-elu-fn-steeve-briois-peut-etre-juge-tweet
LCI du 3 novembre 2017 débat sur le congé paternité
Le Parisien du 3 novembre 2017 sur l'affaire Morandini http://www.leparisien.fr/week-end/des-revelations-des-inrocks-a-la-greve-d-itele-retour-sur-l-affaire-morandni-31-10-2017-7366032.php
TF1 JT de 13H du 31 octobre 2017 sur le scandale des voitures-épaves http://www.lci.fr/france/jt-13h-des-milliers-de-voitures-epaves-remises-en-circulation-illegalement-2068981.html
France Inter du 31 octobre 2017 sur la mort numérique https://www.franceinter.fr/societe/il-y-aura-bientot-plus-de-morts-que-de-vivants-sur-facebook
France Soir du 30 octobre 2017 sur les déguisements pour Halloween http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/halloween-costume-djihadistes-ou-clowns-tueurs-ces-deguisements-sont-ils-legal-terroriste-blague-faire--peur-plaisanterie-interdit-sanction-peines-avocat-thierry-vallat-prank-etat-urgence?platform=hootsuite
C8 du 23 octobre 2017 sur les travailleurs détachés http://replay.c8.fr/video/1466731
LCI du 20 octobre 2017 débat sr le harcèlement https://youtu.be/BDuLn_4TxwE
AlHurra du 20 octobre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge https://www.facebook.com/alhurra/videos/10155602464496136/?hc_ref=ARQgkPNFcNTScvQwmjzSA2zDzZe3kV8d5fF1INqDWj-z8U_qUXakoS8r4QI_D50BR6A&pnref=story
CNews le 18 octobre 2017 sur le harcèlement
L'Express du 17 octobre sur le harcèlement de rue http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html
France Soir du 17 octobre 2017 sur le financement de Daesh par Lafarge http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html
LCI du 16 octobre 2017 sur le harcèlement de rue http://www.lci.fr/societe/harcelement-de-rue-agressions-sexuelles-sifflements-mains-aux-fesses-regards-insistants-frottements-insultes-salaces-tombe-sous-le-coup-de-la-loi-2067534.html
BFM du 15 octobre 2017 débat sur le harcèlement https://youtu.be/_S0NO-Jx9sE
Public Sénat débat du 11 octobre 2017 sur le harcèlement de rue https://twitter.com/twitter/statuses/918156787974422528
LCI du 10 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés http://www.lci.fr/societe/fichage-d-interimaires-chez-leroy-merlin-jusqu-ou-l-employeur-peut-il-legalement-aller-2066948.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Le Figaro du 8 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés Leroy Merlin http://www.lefigaro.fr/social/2017/10/08/20011-20171008ARTFIG00111-boulet-branleur-un-listing-des-interimaires-de-leroy-merlin-declenche-une-enquete-interne.php
Le Parisien du 2 octobre 2017 sur l'interdiction de vapoter au bureau http://La vapoteuse au travail, c'est interdit... sauf exception
FranceInfo TV du 30 septembre 2017 sur les CGU des réseaux sociaux https://www.youtube.com/watch?v=1zfUMU8D3Pg&feature=youtu.be
Runway Magazine du 18 septembre 2017 La Haute Couture pour les nuls http://runwaymagazines.com/haute-couture-dummies/
Le Monde du 18 septembre 2017 sur les Hacker Houses http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/09/18/hackerhouses-le-reve-americain-a-tout-prix_5187246_4415198.html
LCI du 14 septembre 2017 sur le travail des enfants sur les chaines YouTube http://www.lci.fr/societe/enfants-video-youtube-studio-bubble-teales-swan-the-voice-demo-jouets-travail-illegal-loisir-prive-web-2064120.html
Sputnik News du 23 août 2017 sur la réforme du travail détaché https://fr.sputniknews.com/international/201708241032771662-reforme-travai-macron/
Néon Mag du 22 août 2017 sur le logiciel espion Fireworld http://www.neonmag.fr/polemique-fireworld-propose-un-logiciel-espion-pour-decouvrir-si-votre-fils-est-gay-491263.html
France Soir du 21 août 2017 sur les litiges des locations saisonnières http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-votre-vacances-location-saisonniere-maison-hotel-tourne-mal-comment-se-defendre-en-cas-de-litige-droit-loi-regles-avocat-conseils-que-faire-caution-arrhes-acompte-remboursement-degats-internet-thierry-vallat-avocat
France Soir du 8 août 2017 sur le bras de fer entre Bruxelles et les Gafa dont les CGU sont illégales http://www.francesoir.fr/tendances-eco-monde/conditions-generales-utilisation-internet-pourquoi-union-europeenne-menace-facebook-google-et-twitter-utilisateurs-comission-sanctions-amendes-droit-europeen-avocat-thierry-vallat-consommateurs
Lexbase du 27 juillet 2017 édition professions n*245 sur la contestation des honoraires d'un avocat
France Soir du 24 juillet sur les responsabilités en cas de noyade dans une piscine http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/quelle-responsabilite-en-cas-de-noyade-dans-votre-piscine-familiale-particuliers-enfants-regles-dispositif-securite-infractions-peines-amendes-voisin-avocat-loi-droit-thierry-vallat
Libération du 12 juillet 2017 sur les drones de livraison http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/12/vos-achats-livres-par-drone-ce-n-est-pas-pour-tout-de-suite_1583307
France Soir du 7 juillet 2017 sur la règlementation des piscines http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/noyade-quelles-regles-de-securite-pour-les-piscines-en-france-privee-publique-danger-risques-responsabilite-alarme-barriere-couverture-abris-normes-loi-avocat-thierry-vallat
Linfo.re du 12 juin 2017 sur les déclarations de revenus http://www.linfo.re/france/societe/720805-declaration-de-revenus-ce-qu-il-faut-faire-en-cas-d-oubli-ou-d-erreur
L'Express du 31 mai 2017 sur l'affaire Ferrand http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-ferrand-pourquoi-la-justice-n-ouvre-pas-d-enquete-pour-l-instant_1913481.html
Libération du 30 mai 2017 Peut-on se promener en maillot de bain en ville ? http://www.liberation.fr/france/2017/05/30/a-t-on-le-droit-de-bronzer-en-maillot-de-bain-en-ville_1573287
France Soir du 29 mai 2017: surbookings quels sont vos droits ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/surbooking-votre-avion-est-surbooke-quels-sont-vos-droits-compagnies-aeriennes-indemnisations-loi-droit-r%C3%A8gles-avocat-thierry-vallat-montant-remboursement
France Soir du 25 mai 2017 travaux, caution DG sortie du locataire quels recours ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/appartement-depart-sortie-travaux-caution-etat-des-lieux-que-faire-en-cas-de-litige-locataire-proprietaire-regles-droit-avocat-thierry-vallat-loi-recours
Sputnik News du 19 mai 2017 sur l'amende infligée à Facebook par la Commission européenne https://fr.sputniknews.com/international/201705191031458040-facebook-amende-argent/
France Inter du 19 mai 2017 sur les livraisons par drones d'Amazon
BFMTV du 9 mai 2017 sur la légalité de l'allaitement en public http://www.bfmtv.com/international/une-elue-australienne-allaite-son-bebe-au-parlement-serait-ce-possible-en-france-1160372.html
Runway Magazine du 7 mai 2017 sur le décret sur les photos retouchées de mannequins http://runwaymagazines.com/new-fashion-law/
Figaro du 6 mai 2017 sur le délit de diffusion de fake news http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00096-que-risquent-ceux-qui-diffusent-de-fausses-informations-a-l-approche-du-scrutin.php
France Soir du 6 mai 2017 sur le fonctionnement des bureaux de vote http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-bureaux-de-vote-ce-qui-est-autorise-ce-qui-est-interdit-election-scrutin-regles-loi-droit-thierry-vallat?platform=hootsuite
L'Express du 4 mai 2017 sur l'article 97 du code electoral http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/compte-aux-bahamas-pourquoi-marine-le-pen-n-est-pas-inquietee-par-l-enquete_1905248.html
L'Express entreprise du 29 avril 2017 sur l'interdiction du vapotage au travail http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/vapoter-au-travail-sera-interdit-le-1er-octobre-2017_1903561.html
France Soir du 23 avril 2017 sur l'annulation de l'élection présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/peut-annuler-election-presidentielle-resultats-fraude-scrutin-vote-conseil-constitutionnel-thierry-vallat-avocat-droit-loi
France Soir du 20 avril 2017 sur le report de l'election présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/election-presidentielle-pourrait-elle-etre-reportee-report-premier-tour-empechement-candidat-thierry-vallat-avocat-mort-attentat-retrait
France Soir du 19 avril 2017 sur les sondages en période électorale http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-les-regles-relatives-aux-sondages-pendant-la-campagne-officielle-marge-erreur-candidats-medias-premier-second-tour-droit-regles-loi-avocat-thierry-vallat-fiabilite-csa-internet-en-ligne
France Soir du 7 avril 2017 sur les emplois fictifs présumés du FN http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-front-national-fn-presumes-au-conseil-regional-du-nord-pas-de-calais-que-risquent-david-rachelin-enquete-premiminaire-poursuites-peines-avocat-thierry-vallat
France Soir du 14 mars 2017 sur le port du foulard au travail http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/port-du-voile-au-travail-laicite-et-discriminations-la-justice-europeenne-tranche-foulard-loi-droit-cjue-avocat-thierry-vallat-islam-religions?platform=hootsuite
Radio Orient du 14 mars 2017 itw sur l'interdiction du port du voile en entreprise http://www.radioorient.com/cour-europeenne-une-entreprise-peut-interdire-le-port-de-signes-religieux/
France Soir du 11 mars 2017 sur la violation du secret de l'instruction http://www.francesoir.fr/politique-france/penelopegate-qu-est-ce-que-la-violation-du-secret-de-instruction-francois-fillon-penelope-parquet-national-financier-pnf-juges-avocats-thierry-vallat-droit-proc%C3%A9dure
Sputnik News du 10 mars 2017 débat sur l'intelligence artificielle https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201703101030396959-intelligence-artificielle/
Agefi Actifs du 3 mars 2017 sur l'affaire Apollonia http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/affaire-apollonia-letau-se-resserre-autour-des-76473
France Soir du 1er mars 2017 sur le droit à l'oubli sur internet http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-droit-oubli-sur-internet-comment-marche-le-droit-au-dereferencement-moteur-recherche-google-vie-prive-referencement-lois-cnil-europe-justice-droit-thierrry-vallat-avocat-disparaitre
Journal du Management juridique n°55 du 28 février 2017 sur l'obligation de l'employeur de dénoncer ses salariés chauffards http://fr.calameo.com/read/000000178bf08874a4147
L'Opinion du 23 février 2017 sur la plainte pour faux visant Audrey Azoulay http://www.lopinion.fr/edition/politique/ministre-audrey-azoulay-visee-plainte-faux-en-ecriture-publique-120000
France Soir du 22 février 2017 sur la notion de conflit d'intérêt http://www.francesoir.fr/politique-france/affaire-solere-la-notion-de-conflit-interet-en-question-polemique-cadre-legal-loi-thierry-vallat-prise-illegal-interet-fillon-hatvp-cahuzac-deputes-elus
LCI du 17 février 2017 itw sur le slogan en anglais de Paris 2024 http://www.lci.fr/sport/jo-2024-plusieurs-associations-attaquent-le-slogan-en-anglais-de-paris-la-plainte-peut-elle-aboutir-2026377.html
Public Sénat du 14 février 2017 sur le délit de consultation de site terroriste https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-53205
France Soir du 11 février 2017 sur la notion de viol dans l'affaire Théo http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/affaire-theo-aulnay-sous-bois-partir-de-quand-peut-parler-de-viol-violences-loi-droit-avocat-thierry-vallat-policiers-matraque-juge-igpn
BFMTV du 10 février 2017: itw sur les caméras piétons de la police municipale http://www.bfmtv.com/police-justice/cameras-pietons-pour-policiers-un-systeme-anti-violence-et-anti-bavure-1100293.html
France24 du 9 février 2017: itw sur le Parquet national financier http://www.france24.com/fr/20170209-avocats-francois-fillon-penelope-pnf-parquet-national-financier-dessaisir-justice
La Croix du 7 février 2017: itw sur la compétence du Parquet national financier sur l'affaire Fillon http://www.la-croix.com/France/Politique/Le-parquet-national-financier-competent-dans-laffaire-Fillon-2017-02-07-1200823089?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#/link_time=1486475997
Le Monde du 6 février 2017 itw sur le phishing ou le hameçonnage http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/02/06/hameconnage-la-banque-doit-vous-rembourser-si-elle-ne-peut-prouver-votre-negligence_5075315_1657007.html
Libération du 27 janvier 2017 itw sur le sexisme et la modération sur Facebook http://www.liberation.fr/france/2017/01/27/pourquoi-des-feministes-denoncent-la-moderation-de-facebook_1543436
France Soir du 25 janvier 2017 sur les emplois fictifs http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-d%C3%A9finition-quelle-peine-encourue-risques-penelope-fillon-fran%C3%A7ois-loi-droit-jurisprudence-thierry-vallat-avocat
Radio Méditerranée Internationale Interview du 23 janvier 2017 sur les vignettes anti-pollution
Sputnik News du 20 janvier 2017 interview sur le soft power de Facebook https://fr.sputniknews.com/france/201701201029689183-facebook-france-startup/
France Soir du 18 janvier 2017 sur la responsabilité d'EDF en cas de coupures http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/vague-de-froid-quelle-responsabilite-pour-edf-fournisseurs-en-cas-de-coupures-de-courant-electricit%C3%A9-thierry-vallat-droits-lois
Slate du 18 janvier 2017 sur le harcèlement à domicile http://www.slate.fr/story/134768/services-aboli-frontieres-intime
France Soir du 17 janvier 2017: décryptage de l'affaire Buffy Mars http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/sms-de-drague-quelles-sanctions-pour-le-technicien-orange-et-les-harceleurs-de-buffy-mars-harcelement-twitter-facebook-texto
BFMTV du 17 janvier 2017 interview sur la gifle à Manuel Valls et ses conséquences http://www.bfmtv.com/police-justice/manuel-vals-gifle-que-risque-le-jeune-homme-interpelle-1083960.html
Le Parisien du 17 janvier 2017 sur l'affaire Buffy Mars http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/harcelement-une-blogueuse-denonce-puis-se-fait-harceler-sur-twitter-17-01-2017-6579348.php#xtor=AD-1481423553
Le Figaro du 13 janvier 2017 interview sur le fichage illégal des bénévoles de la Croix-Rouge http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/13/01016-20170113ARTFIG00351-quand-la-croix-rouge-fichait-ses-benevoles-en-secret.php
Le Parisien du 7 janvier 2017 interview sur la fermeture du site Babylon 2.0 http://www.leparisien.fr/societe/sur-facebook-babylone-2-0-enfin-ferme-le-groupe-partageait-des-photos-volees-de-femmes-nues-07-01-2017-6538266.php
Neon Mag du 6 janvier 2017 interview sur les groupes Babylon 2.0 et le revengeporn http://www.neonmag.fr/babylone-2-0-le-groupe-facebook-secret-qui-diffuse-des-photos-volees-de-femmes-nues-482095.html
LCI du 28 décembre 2016 interview sur les caméras pour les policiers municipaux http://www.lci.fr/societe/cameras-sur-les-policiers-municipaux-et-les-agents-de-securite-sncf-et-ratp-vous-avez-ete-filme-voici-ce-que-dit-la-loi-2019176.html
Village de la justice du 28 décembre 2016 sur la résurrection numérique et le droit à l'image http://www.village-justice.com/articles/Resurrection-numerique-quelle-legalite-exploitation-image-artiste-mort,23852.html
Sputnik news du 21 décembre 2016 sur le rachat de WhatsApp par Facebook https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201612211029289418-facebook-mensonge-bruxelles/
C8 du 14 décembre 2016 sur la règlementation des drones http://www.c8.fr/c8-docs-mags/pid8478-c8-focus.html
LCI du 30 novembre 2016 sur la surveillance des échanges internet par l'employeur http://www.lci.fr/societe/vie-privee-au-travail-votre-employeur-a-t-il-le-droit-de-surveiller-ce-que-vous-faites-sur-internet-2015021.html
Weka du 16 novembre 2016 sur le rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs http://www.weka.fr/actualite/administration/article/lautorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs-non-accompagnes-redevient-obligatoire-a-partir-du-15-janvier-2017-44552/
Gameblog du 1er novembre 2016 sur le cadre légal des agressions sexuelles virtuelles http://www.gameblog.fr/news/63348-agressee-sexuellement-en-realite-virtuelle-elle-raconte-son-
Konbini du 21 octobre 2016: interview sur le Cyber-harcèlement http://www.konbini.com/fr/tendances-2/cyberharcelement-marre-etre-victime/
Lexbase Ed Professions du 29 septembre 2016 sur le devoir de conseil des avocats
RTS du 29 septembre 2016: itw sur les actions en justice contre Pokemon Go
Vice News du 20 septembre 2016: que risque l'auteur d'une fausse attaque terroriste ? https://news.vice.com/fr/article/que-risque-lauteur-dune-fausse-alerte-terroriste
BFMTv du 19 septembre 2016: débat sur le swatting http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fausse-alerte-terroriste-un-adolescent-a-ete-arrete-dans-la-marne-865457.html
L'Express du 12 septembre 2016 sur l'affaire Morandini http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jean-marc-morandini-veut-etre-entendu-rapidement-par-la-justice_1829584.html
Sputnik News du 9 septembre 2016 débat sur les nouvelles technologies https://soundcloud.com/sputnik_fr/lancement-de-liphone-7-est-ce-que-la-technologie-nous-sauvera-dun-avenir-dystopique-ou-en-creera-t-elle-un
RMC du 8 septembre 2016: débat sur la lutte contre le sexisme http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/aud
BFMTV du 24 août 2016: interview sur les dangers de PokémonGo au bureau http://www.bfmtv.com/societe/jouer-a-pokemon-go-au-bureau-peut-s-averer-risque-1029223.html
France 3 du 12 août 2016 sur l'affaire Take Eat Easy http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-la-fronde-des-livreurs-de-repas-velo-1064893.html
Europe 1 du 12 août 2016: interview sur le dossier Take Eat Easy http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-bonjour/europe-bonjour-julia-martin-120816-2818891
La Croix du 10 août 2016 sur la requalification des contrats des coursiers à vélo http://www.la-croix.com/Economie/Social/Les-livreurs-de-repas-a-velo-se-rebellent-2016-08-10-1200781385
France Inter du 3 août 216 sur les problèmes juridiques posés par l'appli Périscope https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-03-aout-2016
BFMTV du 28 juillet 2016 sur le harcelement sexuel et le travail dissimulé http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/trois-plaintes-deposees-contre-jean-marc-morandini-846243.html
Les Inrocks du 20 juillet 2016: suite de l'affaire Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/19/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-suite-11854401/
Rue89 L'Obs du 15 juillet 2016 sur la diffusion de contenus choquants sur internet http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/15/nice-risquez-si-partagez-photos-victimes-264651
FranceTVInfo du 14 juillet 2016: interview sur l'affaire Morandini http://www.francetvinfo.fr/economie/medias/morandini/affaire-morandini-c-est-du-harcelement-caracterise-affirme-l-avocat-des-acteurs-des-faucons_1546669.html
Les Inrocks du 13 juillet 2016 sur les pratiques de la société de production de JM Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/12/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-11852954/
Sputnik News du 11 juillet 2016 sur le droit à la déconnexion http://Thierry Vallat: Il faudra une charte détaillée qui indique ... - SoundCloud
Radio Canada du 6 juillet 2016 Interview sur la condamnation de Lionel Messi pour fraude fiscale
Sputnik News du 5 juillet 2016 sur les déclaration de Manuel Valls sur le dumping social et la directive de 1996 https://soundcloud.com/sputnik_fr/me-thierry-vallat-ca-me-semble-audacieux-de-dire-quon-nappliquerait-pas-la-directive?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
Slate du 1er juillet 2016 sur Serge Aurier et l'appli Periscope http://www.slate.fr/story/120325/serge-aurier-periscope-paye
Le Journal du Management n°52 (juillet-août 2016): fiscalité des bitcoins et cryptomonnaies http://fr.calameo.com/read/000000178209f1e043d9b
L'Opinion du 15 juin 2016 interview sur les conséquences juridiques du Jasta http://www.lopinion.fr/edition/international/terrorisme-en-voulant-punir-l-arabie-saoudite-senat-americain-provoque-104741?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=content&utm_campaign=cm
La Croix du 16 mai 2016 interview sur le litige entre Uber t l'Urssaf sur le statutd des chauffeurs http://www.la-croix.com/Economie/Social/Pour-l-Urssaf-le-chauffeur-Uber-est-un-salarie-2016-05-16-1200760509
Public Sénat du 13 mai sur les dangers de Périscope http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/periscope-l-application-sans-limites-1347939
La Croix du 12 mai 2016 interview sur l'appli Periscope http://www.la-croix.com/France/Periscope-questions-apres-drame-2016-05-12-1200759614?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#/link_time=1463066713
Sputnik News du 10 mai 2016: interview sur le soutien des avocats français à leurs confrères turcs emprisonnés https://soundcloud.com/sputnik_fr/thierry-vallat-lordre-des-avocats-francais-est-solidaire-des-confreres-turcs-arretes
Public Sénat le 14 avril 2016: débat du sur le fichier PNR
20 MInutes du 14 avril 2016: un employeur qui demande un changement de prénom légal ou pas ? http://www.20minutes.fr/economie/1826595-20160414-employeur-demande-salarie-changer-prenom-legal
RMC du 25 mars 2016: interview de jean-Jacques Bourdin sur le fichier PNR http://www.thierryvallatavocat.com/2016/03/mise-en-place-d-un-fichier-pnr-europeen-et-lutte-contre-le-terrorisme-me-thierry-vallat-interroge-sur-rmc-le-25-mars-2016.html
Le Monde du 22 mars 2016: Peut-on être licencié pour utiliser les réseaux sociaux au travail http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/03/22/peut-on-etre-licencie-pour-utiliser-les-reseaux-sociaux-a-titre-personnel-au-travail_4888193_1698637.html
Sputniknews du 11 mars 2016 sur le jugement américan condamnant l'Iran à indeminiser les victimes du 11 septembre https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201603111023300130-iran-usa-11-septembre/
BFM Business du 3 mars 2016 sur l'usage de twitter au travail http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/tweeter-4-fois-par-jour-au-travail-n-est-pas-un-motif-de-licenciement-957155.html
Ouest France du 25 février 2016 Interdiction du vapotage dans les lieux publics http://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/vapotage-linterdiction-recommandee-dans-tous-les-lieux-publics-4056069
Sputniknews du 25 février 2016 sur l'amende fiscale de 1,6 milliard d'€ infligée à Google http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160226/1022747386/france-google-impots.html#ixzz41XeliIC6
Le Parisien du 21 février 2016 sur le sextorsion http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-sextorsions-envahissent-le-net-21-02-2016-5565269.php#xtor=AD-1481423553
Sputnik news du 18 février 2016 sur la légalité du blocage de sites internet http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160218/1021896666/france-internet-blocage.html
Lexbase (n°641 du 28 janvier 2016): nom de domaine des avocats et art 10.5 du RIN http://images.lexbase.fr/sst/N0913BWQ.pdf
L'Humanité du 12 janvier 2016: le cadre légal du Esport http://www.humanite.fr/loi-numerique-laddiction-portee-de-clic-595184
Village de Justice du 29 décembre 2015: La France se dote d'une nouvelle règlementation sur les drones civilshttp://www.village-justice.com/articles/France-dote-une-nouvelle,21130.html
La Tribune du 17 décembre 2015 sur l'indemnisation des victimes d'attentat http://www.latribune.fr/economie/france/attentats-de-paris-l-indemnisation-des-victimes-atteindrait-300-millions-d-euros-536831.html
D8 interview pour le magazine "En quête d'actualité" du 16 décembre 2015 : la règlementation des drones http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d8-en-quete-d-actualite.html?vid=1342386
Lexbase (n°636 du 10 décembre 2015): précisions sur la consultation des pièces pendant la garde à vue http://images.lexbase.fr/sst/N0227BWC.pdf
Village de la Justice du 23 novembre 2015: le droit de l'Esport dans le projet de loi numérique http://www.village-justice.com/articles/droit-sport-dans-Projet-Loi,20900.html
RT France du 10 novembre 2015: arrêt CEDH Dieudonné https://francais.rt.com/france/10045-cour-europeenne-droits-lhomme-rejette
Radio Orient: débat du 5 novembre 2015 sur la réforme du droit du travail http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=27826
Lexbase du 15 octobre 2015 sur la fragilisation des droits de la defense pendant la grève des avocats http://images.lexbase.fr/sst/N9379BUW.pdf
L'Express du 2 octobre 2015 sur les amendes pour jets de mégots sur la voie publique: http://votreargent.lexpress.fr/consommation/paris-est-elle-la-seule-ville-concernee-par-l-amende-pour-jet-de-megot_1721944.html
Lexbase du 17 septembre 2015 sur les perquisitions en cabinet d'avocats et l'arrêt CEDH Sérvulo c/Portugal http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_625.pdf
Archimag n°287 de septembre 2015: neutralité et loyauté des plateformes numériques http://Numéro 287 : Démat des factures : passage à l'acte
Vice News du 31 août 2015 sur les soupçons de chantage dans l'affaire Eic Laurent/Roi du Maroc https://news.vice.com/fr/article/les-deux-journalistes-francais-accuses-davoir-fait-chanter-le-roi-du-maroc-ont-donne-leur-version-des-faits
Village de la Justice du 21 août 2015: pour un véritable droit au renvoi d'audience http://www.village-justice.com/articles/Pour-veritable-droit-renvoi,20261.html
Version Fémina du 6 juillet 2015 sur les sanctions pour abandon de détritus sur la voie publiques
Lexbase du 2 juillet 2015 sur les honoraires de postulation
France Info: interview du 10 juin 2015 sur l'interdiction de l'appli Gossip https://www.youtube.com/watch?v=o14NjTYrVVk
Sud Radio: débat du 4 juin 2015 sur portable et harcelement scolaire http://www.sudradio.fr/Podcasts/Seul-contre-tous/Gossip-il-faut-interdire-le-portable-avant-la-fin-du-lycee
L'Obs du 4 juin 2015 sur les drones de l'info
Libération du 3 juin 2015 sur l'application Gossip http://www.liberation.fr/societe/2015/06/03/gossip-l-appli-accusee-de-favoriser-le-harcelement_1322045
Europe 1 Interview du 2 juin 2015 sur le cyber harcèlement http://www.europe1.fr/societe/gossip-lapplication-dans-le-viseur-des-associations-1350076#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Weka du 18 mai 2015: Pollution de l'air procdure d'infraction de la Commission Européenne contre la France http://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/pollution-lair-particules-fines-procedure-dinfraction-commission-europeenne-contre-france/
La Tribune du 23 avril 2015: "2 ans après le Rana Plaza" interview sur le devoir de vigilance et responsabilité sociétale des entreprises http://www.latribune.fr/edition-quotidienne/23-04-2015/focus/commerce-ce-que-le-rana-plaza-a-change-1447.html#enrichments_article
Lexbase (n°608 du 9 avril 2015): vers l'élaboration d'un véritable droit des drones http://images.lexbase.fr/sst/N6841BUW.pdf
Metronews du 23 mars 2015: interview sur les poursuites pénales contre les bénéficiaires d'un bug informatique dans une station service http://www.metronews.fr/info/bug-dans-une-station-service-de-l-herault-les-clients-m-insultaient-et-me-bousculaient-pour-pouvoir-faire-le-plein-a-5-euros/mocw!FhNku0n2vQraE/
Expoprotection du 16 mars 2015: "les employeurs condamnés à prévenir le burn-out" http://www.expoprotection.com/?IdNode=1571&Zoom=1fbf527b7549e1ea4635c97e6f06fcc0&Lang=FR
Europe 1: interview du 11 mars 2015 sur le swatting et les risques pénaux encourus http://www.europe1.fr/societe/swatting-que-risquent-les-auteurs-de-ces-canulars-made-in-usa-2396671
Weka du 9 mars 2015 "contrats de génération: un décret du 3 mars 2015 en facilite l'accès" http://www.weka.fr/actualite/emploi/article/contrats-generation-decret-du-3-mars-2015-en-facilite-lacces/
Vice News du 7 mars 2015: interview sur le jugement Facebook du 5 mars 2015 https://news.vice.com/fr/article/facebook-courbet-justice-francaise
LCI (6 mars 2015): interview sur le sexisme au travail http://videos.tf1.fr/infos/2015/le-sexisme-au-travail-redoutable-instrument-d-exclusion-8575434.html
Lexbase (n°603 du 5 mars 2015): braconniers du droit ou plate-forme juridique légale les enseignements du jugement avocat.net http://presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_603.pdf
Lexbase (n°601 du 12 février 2015): le droit d'accès de l'avocat au dossier complet de l'information http://www.presentation.lexbase.fr/la-lettre-juridique-ndeg601-du-12-fevrier-2015
Metronews du 10 février 2015: interview sur la fraude fiscale après le swissleaks http://www.metronews.fr/info/swissleaks-hsbc-fraudeurs-fiscaux-voici-les-bons-conseils-du-fisc-pour-vous-en-sortir/mobj!HKyMtcffg25A/
Vice News du 6 février 2015: interview sur la violation du secret de l'instruction https://news.vice.com/fr/article/36-quai-orfevres
Lexbase (n°598 du 22 janvier 2015): "menaces de mort à un avocat" http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_598.pdf
ETV (14 janvier 2015): intervention dans le reportage du magazine d'information estonien Pealtnägija sur la contrefaçon http://uudised.err.ee/v/majandus/aee45037-b7f0-4356-9044-7277ab86724f
Le Nouvel Economiste du 9 janvier 2015: "défiscalisation immobilière, aides et conseils" http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/defiscalisation-immobiliere-aides-et-conseils-25647/
Weka du 15 décembre 2014:"le sandale des dons de RTT encore interdits de fait aux agents publics" http://www.weka.fr/actualite/rh-publiques-thematique_7849/le-scandale-du-don-de-rtt-encore-interdit-de-fait-aux-agents-publics-article_8628/
Le Figaro du 21 novembre 2014: "Crime organisé le nouveau statut des repentis" http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/21/01016-20141121ARTFIG00436-crime-organise-le-nouveau-statut-du-repenti-en-cinq-questions.php
BFM Business l'Atelier numérique du 8 novembre 2014 débat sur la règlementation des drones civils http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-0811-atelier-numerique-17h-18h-119937.html
RMC: interview du 31 octobre 2014 sur le démarchage des avocats
BFM Business émission-débat du 21 octobre 2014 sur la pénibilité au travail http://bit.ly/1wsG7lP
ExpoProtection du 13 octobre 2014: "les 6 décrets sur la pénibilité au travail viennent d'être publiés" http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_professionnels_naturels__industriels/Zoom_article,I1571,Zoom-fed7eb81350aeaa93a0129555ee4db66.htm
Atlantico.fr (23 septembre 2014): interview sur les fraudes aux aides sociales par les britanniques installés en France http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-britanniques-installes-en-france-pour-qui-aventure-tourne-au-cauchemar-pauvrete-voire-fraude-catharine-higginson-thierry-1760330.html#3buYAEZKEpoSO7wJ.01
Le Monde du Droit (9 septembre 2014): "faire et défaire la loi ALUR: quelle cohérence ?") http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/194351-faire-et-defaire-la-loi-alur-quelle-coherence-.html
LCP-Public Sénat ( 28 juin 2014): interview sur l'arrêt Baby Loup du 25 juin 2014 e le principe de laïcité https://www.youtube.com/watch?v=1Lui5Cma1lE
Le Figaro (17 juin 2014): interview sur les exonérations de taxe d'habitation http://www.lefigaro.fr/impots/2014/06/17/05003-20140617ARTFIG00302-taxe-d-habitation-les-exonerations-pourraient-faire-augmenter-les-impots.php
Cahiers Lamy du CE (n°138 de juin 2014): "attaques en règle contre le forfait-jours"http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlEjDiJnIoHkKoHl/presse/cce/les_cahiers_lamy_du_ce_2014/attaques_en_regle_contre_le_forfait_jours__resistera-t-il_au_temps_qui_passe_
BFM TV (31 mai 2014): interview sur Google et le droit à l'oubli numérique https://www.youtube.com/watch?v=Jzyg0eCldiQ
Cahiers Lamy du CE (n°135 de mars 2014) : « vapoter au bureau : vrai droit ou fumeux détournement de la loi Evin ? »http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/74306/vapoter-au-bureau-vrai-droit-ou-fumeux-detournement-de-la-loi-evin-.html
Journal du management juridique (mars 2014) : « Intensification de la lutte contre la fraude fiscale » http://issuu.com/legiteam/docs/jmj39/11?e=1003431/7212830
Cahiers Lamy du CE (n°132 de décembre 2013) : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/71878/que-reste-t-il-du-repos-dominical-en-2013-l-imbroglio-autour-du-travail-le-dimanche.html
Terrafemina du 29 novembre 2013: ''Qu'est-ce que la notion de légitime défense?'' http://www.terrafemina.com/societe/societe/articles/33862-braqueur-tue-a-sezanne-quest-ce-que-la-notion-de-legitime-defense-.html
TV News du 16 novembre 2013 "Le travail dominical": http://www.youtube.com/watch?v=ixE3IqtIUls
Metronews du 7 novembre 2013 "Il y a urgence à légiférer sur la géolocalisation des portables":http://www.metronews.fr/info/geolocalisation-des-portables-il-y-a-urgence-a-reflechir-a-une-loi/mmkf!XBe1c5mEcyITs/
Droit-Inc du 7 octobre 2013: "démarchage de clientèle: oui ou non ?" http://www.droit-inc.fr/article10825-Demarchage-de-clientele-Oui-ou-non
Europe 1 le 30 septembre 2013: "Travail le dimanche: quel impact économique" http://www.europe1.fr/Economie/Travail-le-dimanche-quel-impact-economique-1657923/
Revue Fémina du 3 au 9 juin 2013: "Accords emplois: ça change quoi ?
Revue Management (mars 2013): Article dans la revue "Management" de mars 2013: "Les contrats de génération: ce qui va changer"




/image%2F0932369%2F20200613%2Fob_093db5_17243-bas.jpg)
/image%2F0932369%2F20210907%2Fob_71cd24_79-b.jpg)
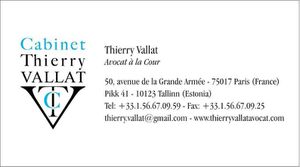
/idata%2F2936038%2FLe-Cabinet-en-images%2F2321-HAUT.jpg)